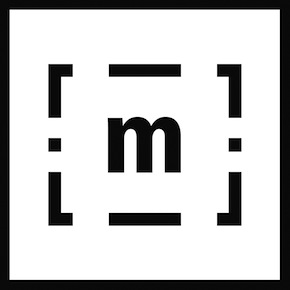 Le patrimoine attire les foules lors d’événements (Fête des Jardins, Journées du patrimoine, Nuit blanche…), les grandes expositions (Monet, Dali, Sciences & curiosités à la Cour de Versailles…) créent des queues et la nécessité de réserver. Et pourtant les musées vont mal. Ils vont mal dans la définition de leur mission et de leur rôle dans la société, comme ils vont mal chez celles et ceux qui en font profession. Le musée, ce conservatoire d’œuvres et d’objets, est-il devenu obsolète, à nouveau vu comme mortifère et élitiste ? Faut-il orienter ailleurs les jeunes qui persistent à vouloir travailler dans ces vecteurs de diffusion vers des publics physiques et en ligne ?
Le patrimoine attire les foules lors d’événements (Fête des Jardins, Journées du patrimoine, Nuit blanche…), les grandes expositions (Monet, Dali, Sciences & curiosités à la Cour de Versailles…) créent des queues et la nécessité de réserver. Et pourtant les musées vont mal. Ils vont mal dans la définition de leur mission et de leur rôle dans la société, comme ils vont mal chez celles et ceux qui en font profession. Le musée, ce conservatoire d’œuvres et d’objets, est-il devenu obsolète, à nouveau vu comme mortifère et élitiste ? Faut-il orienter ailleurs les jeunes qui persistent à vouloir travailler dans ces vecteurs de diffusion vers des publics physiques et en ligne ?
Même si un lourd silence angoissé accompagne les personnels d’Etat ou des collectivités locales peu habitués à exprimer leur exaspération, ce sont les même craintes qui remontent de toutes les discussions sur le territoire : mépris de la profession par des tutelles autoritaires ou indifférentes, privatisation et risque de fusion ou de fermeture des établissements, obligation de rendement par de l’événementiel sur des thématiques à forte visibilité. Bref, après le « boom » des musées, les musées-alibis, garde-meubles dépassés mutant vers les nécessités des loisirs de masse ?
Les grands contre les petits ? L’événement contre les institutions ?
L’histoire des musées est – disons-le – une histoire de collections : les musées sont les lieux de conservation du patrimoine mobile, souvent dans des bâtiments de patrimoine immobile. Issus des cabinets de curiosité (le château Ambras en Autriche à la Renaissance) et des sociétés savantes au XIXe siècle, le musée est à son origine pluridisciplinaire sinon encyclopédique : il mêle l’œuvre d’art, l’artisanat décoratif, les curiosités de la vie quotidienne, l’objet historique et l’inventaire scientifique de la planète. Le musée est ainsi le temple des reliques et le lieu de collections pédagogiques.
Au XXe siècle, se développe un vecteur singulier : l’exposition temporaire. Elle prend tellement d’importance que désormais plus aucun musée n’envisage de parcours permanent Le Musée de la Civilisation à Québec, pionnier, avait choisi de se structurer en expositions à temporalités différentes dès sa conception par Roland Arpin en 1988. A plus petite échelle, le Musée d’histoire contemporaine-BDIC décidait dès 1985-86 d’abandonner ses surfaces permanentes pour densifier la politique d’expositions temporaires. Désormais, le Centre Pompidou veut aussi donner des lectures différentes de la collection permanente à travers des accrochages renouvelés, globalement ou par module. D’autres (Louvre, Versailles) essaient d’instiller de l’art contemporain dans le permanent ou des expositions-dossiers, pour faire « actualité ».
Par l’exposition, le musée est entré ainsi dans l’offre culturelle actualisée. Ce fut d’ailleurs depuis longtemps un vecteur pour les artistes, soit en plaçant des œuvres-pivots dans des expositions traditionnelles (les « Fauves » au Salon d’automne de 1905, Marcel Duchamp à l’Armory Show en 1913), soit en faisant du parcours visuel un manifeste (les futuristes, Dada, les surréalistes). Cela a conduit les muséographes à ne plus être juste des « conservateurs » de musée, c’est-à-dire des collecteurs et gardiens des collections, mais à définir des politiques culturelles et à faire des expositions-créations (Paris-Berlin, Paris-Moscou…). Nous pensons en France à des personnages comme François Mathey, Pontus Hulten, Jean-Hubert Martin, Jean Clair…
Tout cela a pris une telle ampleur que la collection est souvent un prétexte ou une monnaie d’échange. Dans les musées d’histoire, l’œuvre ou le document furent instrumentalisés (parfois avec de mauvaises reproductions) pour des expositions idéologiques et démonstratives (années 1960 et 1970). Dans les musées d’art, des « blockbusters » (Vinci, l’impressionnisme, Van Gogh, Vermeer…) tirent, parfois de façon abusive (une ou quelques œuvres prétextes), des opérations attrape-public pour d’évidentes raisons commerciales. Parallèlement, des années 1970 aux années 1990, s’est développée une époque du « Hourra musées ! » avec créations d’institutions partout accompagnant à la fois l’ère du tourisme et des loisirs, l’ouverture des pratiques artistiques et de la conservation mémorielle au temps des mutations économiques et sociales, ainsi qu’une ouverture à tous les continents.
Disons-le, cela s’est réalisé sans vraie réflexion sur l’aménagement général du territoire. Et les modes ont passé. Les écomusées, bastion d’une culture paysanne idéalisée au moment de la transformation des campagnes, ont vieilli et beaucoup n’ont pas su devenir des vrais musées d’histoire problématisés. Des centres et lieux d’art peinent par absence de vraie réflexion sur les accompagnements des publics locaux. Les musées patrimoniaux, d’art et d’histoire souvent, se trouvent confrontés avec la question de la traduction contemporaine de ce qu’ils présentent (l’art religieux ou allégorique est devenu incompréhensible pour beaucoup). Les musées scientifiques, souvent liés à des institutions d’enseignement et de recherche, deviennent des collections en déshérence dépassées par les parcs à thème scientifiques.
Bref, quand le musée-conservatoire se transforme en institution culturelle multimedia avec la nécessité de s’adapter à des publics aux attentes nouvelles in situ et en ligne, les conséquences sont lourdes. La distance entre grandes institutions devenues des « marques » (Louvre, Versailles, Centre Pompidou…) et le reste des musées est considérable. La plupart des milliers de musées semble peu performante face à l’événementiel. La commercialisation et le mécénat se concentrent sur les « marques ». Le mécénat fonctionne très mal en France, loin du modèle de la redistribution sociale anglo-saxonne ignorant contrepartie de visibilité ou contrôle. Ici, il devient le moyen d’avantages fiscaux et de communication peu chère avec des conditions léonines (allant jusqu’au choix des sujets, des artistes, des œuvres, des curateurs). Enfin, tant d’institutions pâtissent de leur dépendance totale vis-à-vis des tutelles pour ne plus être le résultat d’un contrat entre des professionnels reconnus dans leurs compétences et leurs bailleurs de fonds sur la base d’un programme culturel, mais les dirigeants ne dirigent plus, faisant l’objet de diktats des politiques, d’oukases des lobbies divers et des fantaisies des services de communication.
La culture a perdu au profit de la communication.
Des professionnels marginalisés dans des professions en complète mutation
Nul étonnement que les professionnels de musées soient quelque peu déboussolés et déprimés. Ils passent l’oral du concours de conservateur, hyper sélectif et spécialisé, comme l’oral du concours de l’ENA et, ensuite, se retrouvent à faire des « ménages » pour des décideurs extérieurs peu compétents ou des élus voulant faire plaisir à unetelle ou untel. Combien d’exemples de directeurs d’institutions apprenant par hasard l’exposition qu’ils vont accueillir l’année prochaine sans aucune concertation ? Combien de conservateurs de grandes institutions ne pouvant pas réaliser les expositions qu’ils souhaitent ou pas associés aux opérations projetées ? La défunte Maison d’histoire de France fut confiée à des historiens –qui accaparèrent le débat public sans souvent avoir organisé une seule exposition de leur vie— pas à des muséologues, un peu comme si la conception d’une boucherie était dévolue à des spécialistes de l’anatomie animale. Défaite cuisante d’une profession marginalisée, sinistrée même, qui pourtant souvent a –naïvement ?— l’amour de l’intérêt commun chevillé au corps... Mais il s’agit aussi d’un phénomène plus général : la disparition des savants et des créateurs comme modèle social visible, par rapport aux sportifs ou aux acteurs par exemple.
L’origine spécifiquement française de cette défaite tient dans le fait d’avoir laissé des gestionnaires diriger les grands établissements. Jamais un conseiller de A. Merkel, D. Cameron ou B. Obama n’aurait l’idée d’aller prendre la direction d’un grand établissement culturel. En France, cela s’est multiplié, avec des réussites individuelles –reconnaissons-le—comme Stéphane Martin menant à son terme le Quai Branly et ouvrant ensuite son image par une politique culturelle très active, multipliant les événements. Mais cela a contribué surtout à déconsidérer une profession déboussolée. Elle y a une part de responsabilité, quand les conservateurs très corporatistes ont voulu avoir l’exclusivité de la direction des établissements (souvenons-nous des soubresauts au Musée d’Orsay pour installer Serge Lemoine).
En fait, cela résulte fondamentalement d’une évolution des professions entre trois blocs : la conservation et la valorisation des collections au sens strict ; la gestion et la commercialisation ; la politique culturelle et la communication. Tous les conservateurs ne sont pas aptes à communiquer, gérer, bâtir une politique culturelle, animer recherche et pédagogie. Alors, oui, il faut ouvrir ces professions et assurer des passages entre les ministères et la fonction publique d’Etat et territoriale. Oui, il faut identifier les spécialités dans des métiers qu’on ne peut plus appeler uniformément de « conservateurs ». Oui, il faut affirmer ou réaffirmer la prééminence de la politique culturelle sur la gestion et la conservation. C’est ainsi que pourront être nommés des professionnels reconnus, ayant fait leurs preuves, issus aussi bien du monde de la conservation que de celui de la recherche ou de la muséographie en général. Car l’ascenseur est en panne. Si tous les postes de directions importantes sont confiés à des gestionnaires ou des amis politiques, aucun professionnel brillant n’a d’avenir dans ce pays.
Ce phénomène est d’autant plus patent qu’il n’existe plus de relai entre la base et le sommet. L’ex-Direction des musées de France devenue Service des musées de France est en totale déshérence. Il est loin le temps où Jacques Sallois allait sur le terrain, encourageait les initiatives, parlait directement au ministre ou au Président de la République. Le fil est coupé entre la masse des musées et les responsables étatiques. Au niveau local, à part des réussites par la connivence des élus et des responsables d’institutions (à Nantes, la rénovation du Musée-Château des Ducs de Bretagne), les professionnels se sentent très seuls et peu écoutés : on ne se fait plus réélire sur une politique muséale ; le musée semble dispendieux et peu dynamique dans l’événementiel. Enfin, les grands établissements publics ne jouent aucun rôle d’animation de réseaux sur le territoire (le Louvre pour les musées de Beaux-Arts, le Centre Pompidou pour les musées d’art moderne et contemporain, le château de Versailles pour les musées d’histoire, le MUCEM pour les musées de société ou le Muséum d’histoire naturelle pour les musées scientifiques). Cela vient de la crainte des « petits » d’être absorbés, certes. Cela vient aussi de la volonté d’autonomie des « marques blockbusters ». Mais l’avenir est au travail en réseaux, du local au planétaire.
Alors, transformer les formations, clarifier les professions, les hiérarchies, mais dans quel nouveau panorama ? Vers quels buts ?
Les musées multimedia, repères et vitrines de la société
Les musées sont l’exact reflet de la période rétrofuturo qui s’ouvre. Elle est rétro parce que nous n’envisageons plus de faire table rase du passé. Pour autant, nous ne pouvons entrer dans l’ère du tout-conservation publique. Nous devons organiser une conservation partagée, comme nous devons d’ailleurs choisir ce que nous restaurons et là où s’impose le respect du passage du temps (contre le tout-restauration, la disneylandisation du patrimoine). Parallèlement, nous avons besoin d’innover par de nouveaux sujets, de nouvelles perspectives (l’écologie, les images numériques, les actions hors les murs physiques ou virtuelles…), d’autres types de collections, des bâtiments inventifs, des lieux inédits… Les musées s’inscrivent totalement dans cette perspective.
Ils cumulent des atouts croisés : le patrimoine immobile (bâtiments, paysages…), le patrimoine mobile (collections), la culture immatérielle (objets symboles, lieux-signes, mémoires locales…). Nos réalités sont stratifiées désormais et pas en concurrence mais en complémentarités. Les musées sont locaux, régionaux, nationaux et peuvent avoir une portée internationale. Voilà pourquoi culture, tourisme, diffusion multimedia doivent aller de pair. Mais à condition d’abord de conduire des réflexions sur l’aménagement du territoire culturel, région par région et au niveau national. Au temps de vaches maigres, il faut probablement repenser la conservation de façon partagée et coordonnée, savoir ce qu’on veut mettre en avant, ce qui doit faire signe ou sens, dans ce qu’on peut appeler une Local Pride (« j’aime où je vis et je sais pourquoi ») qui comprend l’innovation et l’image qu’on souhaite donner à l’extérieur pour des raisons culturelles et économiques.
Les musées ne peuvent plus doublonner comme c’est le cas, ni se perpétuer sans projet culturel, sans inscription locale, sans rôle dans la diffusion du savoir comme dans les développements territoriaux diversifiés. Les grandes institutions ont un devoir d’animation. Les petites ont toute leur utilité si elles constituent des pôles d’excellence identifiés en réseau. Le ministère de la Culture enfin, sauf à disparaître, doit redéfinir ses missions au XXIe siècle. Pour les musées, il faudrait transformer le Service des musées de France en une Agence nationale des musées qui puisse conseiller, abriter les réseaux autour des grands établissements, démarcher les régions pour aider à se structurer et à définir des points-phares culturels, rassembler l’offre culturelle et pédagogique multimedia dans des plates-formes régionales, nationales et à destination des autres continents.
Car l’enjeu des musées aujourd’hui, c’est bien la reconquête du local par une politique culturelle réfléchie entre les élus et des professionnels respectés, la capacité à faire image et signal pour toutes les associations et entreprises, tout en structurant un territoire en réseaux, territoire qui est à la fois géographique et immatériel. Désormais, l’action du musée hors du musée va devenir souvent plus importante que le résultat des simples visites physiques. C’est à cette aune qu’il faudra mesurer son impact au temps où les professions du patrimoine mobile se rapprochent (bibliothèques, médiathèques, musées, documentations…). C’est ainsi qu’ils devront jouer un rôle majeur dans le nouvel impératif éducatif et civique de notre époque : apprendre à lire fut en effet l’enjeu des siècles précédents ; apprendre à voir est celui de notre planète interconnectée.
Il est donc urgent de clarifier les rôles de chacun et de ne pas rater les perspectives du futur, sauf à décider un laisser-faire qui tuera les petits, conduira au diktat du commerce et de potentats méprisant le savoir et la découverte, finissant aussi par rendre inutile un ministère réduit aux acquets. Les parcs d’attraction ont leurs mérites. Les lieux d’émerveillement et de savoir devant des collections ont les leurs, dans une vue directe comme dans des vues indirectes, dans la pédagogie, la recherche, comme dans l’événementiel ou la commercialisation. Gageons que ce bel enjeu ne pourra se faire que dans la coordination et la complémentarité pour des professions respectées dialoguant avec les élus, un Etat ouvert aux transformations et des grands établissements soucieux de l’épanouissement de tous.
Président du Réseau des musées de l’Europe
