Le phénomène se répand jusque dans les musées, c’est le syndrome de « celles et ceux », de « elles et ils », des « Françaises et des Français ». Il consiste à vouloir obstinément distinguer les femmes des hommes. Les en distinguer, c’est-à-dire les en séparer pour mieux les valoriser. Est-ce le meilleur moyen ? Peut-être aimeraient-elles, les femmes, que l’on oublie leur sexe ? Peut-être voudraient-elles être traitées sur un pied d’égalité avec les hommes (dont le genre n’est pas souligné au moindre de leur mouvement). Mais pour être leurs égales, encore faudrait-il être avec eux. Confrontées à eux. Et traitées avec la même exigence.
Or, tétanisés par la prédominance - évidente et logique - des artistes masculins dans leurs collections d’art ancien, les musées s’arrachent sur le marché des œuvres dont le principal intérêt n’est plus la qualité artistique, mais la féminité de leurs auteurs. Les femmes de talent méritent mieux que cela. Dans les expositions, tous les prétextes sont bons pour les réunir. Artistes, modèles ou commanditaires, elles forment apparemment une entité homogène, à croire qu’elles occupent toutes la même place dans la société, adoptent le même point de vue, partagent les mêmes aspirations, de même que toutes sentent la rose et boivent du jus de papaye, c’est bien connu. Alors on les rassemblent. L’union fait la force, dit-on ? Pas toujours. On frôle souvent l’effet poulailler, à force de les agglutiner dans une jolie cage, bien protégées du loup.
Elles sont actuellement au cœur de trois expositions qui s’arrêtent sur trois périodes différentes : les femmes de pouvoir à la Renaissance au château de Blois, les héroïnes romantiques au Musée de la Vie Romantique, et les pionnières des années folles au Musée du Luxembourg. Si les héroïnes romantiques constituent un véritable sujet, pourrait-on sérieusement envisager une exposition sur « les hommes de pouvoir à la Renaissance » ou « les artistes masculins des années 1920 » ? Le fait que les femmes soient moins visibles et moins nombreuses sur la scène artistique ne justifient pas qu’on les agglomère et qu’on les noie dans des sujets bien trop vastes, bien trop vagues.
Ces trois expositions ont ainsi plusieurs points communs : elles préfèrent être dans l’air du temps plutôt que de creuser un sujet scientifique, privilégient un discours simplifié, et choisissent de montrer que les femmes sont des victimes qui ont dû lutter pour s’imposer dans une société qui les opprimait.
-

- 1. Raymond Auguste Quinsac Monvoisin (1794–1870)
La Mort de Charles IX, 1834
Huile sur toile - 233 x 291,5 cm
Montpellier, Musée Fabre
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
Château de Blois : la Renaissance des femmes
À Blois, l’exposition se concentre - c’est un bien grand mot - sur trois femmes de pouvoir : Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et Marguerite de Valois. Comment ont-elles exercé ce pouvoir ? Comment leur image a-t-elle évolué au fil des siècles, assombrie souvent par la légende qui les nimbe ? Telles sont les deux questions posées. Les réponses seront peut-être données dans une prochaine exposition, qui sait ? Le parcours commençait bien pourtant, avec cette confrontation saisissante de deux images de Catherine de Médicis (ill. 1 et 2) : le peintre Raymond Quinsac Monvoisin la mit en scène en 1834, toute de noir vêtu, inquiétante, presque menaçante devant Charles IX, son fils mourant, qui hésite à lui remettre l’acte de régence ; près du jeune roi tourmenté se tient son épouse la douce Élisabeth d’Autriche qui tente de l’apaiser alors qu’il pointe un doigt fébrile vers la fenêtre, hanté par le souvenir de la Saint-Barthélemy. L’autre tableau, conçu au XVIe siècle, montre une toute autre vision de la reine, jeune et souriante, fastueusement vêtue. Il est dommage que cette peinture ne soit que la copie d’un original du XVIe, réalisée au XIXe siècle, ce qui fausse un peu le propos de l’exposition.
-

- 2. France, fin du XIXe siècle
Catherine de Médicis en pied
Copie, d’après l’original attribué à Germain Le Mannier (actif de 1537 à 1559)
et conservé à la Galerie Palatine au Palais Pitti (Florence, Italie).
Huile sur toile - 194 x 110 cm
Chaumont-sur-Loire, domaine régional
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
Que faut-il donc retenir de la grande Catherine de Médicis ? Pas grand chose fort heureusement. Il ne faudrait pas encombrer l’exigu cerveau des visiteurs. Ils se contenteront d’apprendre qu’elle a eu « l’occasion d’exercer des responsabilités politiques : le roi [son nom n’est pas donné] lui confie la présidence du Conseil chaque fois qu’il s’absente longuement. La régence lui est ensuite confiée après la mort de François II et après celle de Charles IX. [1] » Et voilà tout. Signalons au passage que ces deux régences n’eurent pas tout à fait la même durée, et ne s’exercèrent pas dans les mêmes conditions, mais on ne va pas pinailler. Quelles décisions prit-elle qui marquèrent l’histoire de France ? Quel était le contexte politique ? Tout doux...! L’accumulation d’informations serait indigeste. Le propos sur Catherine de Médicis est à ce point parcimonieux qu’il peut être retranscrit en note [2] et révèle moins la manière dont elle fut perçue par l’histoire que la manière dont le public est perçu par le château de Blois : une bande de benêts. Inutile d’aller chercher de la matière dans le catalogue, seul un album a été publié à cette occasion qui ne reproduit pas toutes les œuvres exposées et reprend les textes frugaux des salles. Peut-être apprendra-t-on davantage de choses en lisant un petit livre sur Catherine de Médicis édité par Quelle Histoire qui a le mérite de s’adresser explicitement à des enfants.
-

- 3. D’après François Clouet (1515-1572)
Diane de Poitiers, dame de Brézé, duchesse de Valentinois (1499-1566) , 1550
Huile sur panneau - 64 x 54 cm
Ecouen, Musée national de la Renaissance
Photo : RMN-GP/Gérard Blot - Voir l´image dans sa page
La section consacrée à Diane de Poitiers (ill. 3) détaille surtout ce que furent les « dames de faveur » en général, et s’arrête sur le « corps féminin, objet de désirs », en précisant que le thème de « la beauté idéale » connut une grande popularité en France au XVIe siècle. Au XVIe siècle spécifiquement ? Faut-il en conclure que les artistes des XVIIe et XVIIIe siècles furent les initiateurs du réalisme, ou peut-être qu’ils manifestèrent un certain penchant pour les laiderons ?
Et Diane ? Le discours qui lui est réservé est tellement laconique qu’il en est poétique, digne de Verlaine, « plus vague et plus soluble dans l’air / Sans rien en lui qui pèse ou qui pose ». On se contentera de savoir que sa position de favorite est « due en premier lieu à sa haute naissance ainsi qu’à l’éminent statut de son mari dans la hiérarchie politique. On retient aussi qu’elle fut « gouvernante en chef » des enfants royaux, rôle qu’elle assura avec intérêt ». Emballez c’est pesé ! Personne suivante : Marguerite de Valois.
Celle-ci termine le parcours, ainsi présentée : « Aujourd’hui toute la réalité de son influence et de son pouvoir est occultée par l’image qui s’impose dans la culture populaire et l’imaginaire collectif celle de la Reine Margot. ». En effet, « son influence et son pouvoir » sont tellement bien « occultés » par la légende diffusée par Alexandre Dumas et alimentée par la suite, que même cette exposition oublie de les détailler ! Où donc est-il signalé qu’elle participa à la conjuration des Malcontents, s’opposant ainsi à son frère Henri III, puis qu’elle prit le parti de la Ligue ? Nulle part. Le point d’orgue du parcours est la robe ensanglantée de la reine Margot incarnée par Isabelle Adjani dans le film de Patrice Chéreau (ill. 4). Et puis des affiches du film et des couvertures plus aguicheuses les unes que les autres du roman d’Alexandre Dumas. Quelles œuvres sont mises en contrepoint pour mettre en valeur qui elle fut réellement ? Un portrait par Clouet, un cabinet en noyer, une table de jeu, sans autres commentaires, tandis que le texte de la salle se complaît encore une fois dans les généralités : « la reine [mais quelle reine ?] forme les femmes de son entourage, qui s’affirment très vite comme des modèles de civilité grâce à leur personnalités brillantes. » Cette exposition en fin de compte est un bel exemple de prétérition : elle fait mine de détruire une image croustillante - la reine noire, la courtisane, la femme incestueuse et délurée - tout en l’exhibant pour mieux appâter le public.
-

- 4. Vue de l’exposition
Affiche du film La Reine Margot 1993
Paris Cinémathèque française
Costume porté par la reine Margot interprétée par Isabelle Adjani,
film réalisé par Patrice Chéreau en 1993
Paris cinémathèque française
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
Le choix de ces trois personnages n’est nulle part justifié. Or, s’il s’agit de présenter des figures de pouvoir, la présence de Marguerite de Valois semble assez discutable, qui fut rapidement évincée de la scène politique, et fut vingt ans en exil.
Elles étaient nombreuses pourtant, à pouvoir postuler, Anne de Bretagne tout d’abord, qui mourut à Blois. Le parcours s’ouvre sur un clin d’œil à Anne de France présentée comme une « pionnière de cette renaissance des femmes ». Pourquoi ? Parce qu’elle est la première à avoir animé un cercle de femmes. Pauvre Anne qui fut deux fois régente du royaume de France, la voilà réduite à bien peu de chose. Fort heureusement une exposition lui est pleinement consacrée à Moulins (article à venir).
Les commissaires ont en outre obtenu le prêt exceptionnel du traité de Cambrai, autrement dit la Paix des dames ; c’était l’occasion de mettre en valeur ses deux négociatrices, Louise de Savoie et Marguerite d’Autriche, en précisant au passage que cette dernière grandit à la cour de France ! Mais non. Louise de Savoie a été autrement mise en valeur par Écouen (voir l’article).
Toute l’exposition est ainsi ponctuée d’allusions à d’autres femmes ; une galerie de portraits accompagnés de résumés biographiques fait surgir Elisabeth d’Autriche, Diane de France, Anne d’Este, Marie de Médicis... Plutôt que d’expliquer leur rôle, on souligne leur nombre. Sur une cimaise une litanie de noms veut rendre justice à des femmes qui eurent une certaine importance à leur époque, mais que l’Histoire a oubliées. Raté ! Cette exposition, au contraire, enfonce le clou : elles resteront sagement dans les abymes puisque rien n’est dit à leur sujet.
Blois avait pour ambition de « réhabiliter l’histoire des femmes pendant la Renaissance, des femmes au pouvoir évident, freinées dans leur progression, valorisées ou dévalorisées au fil des siècles par la littérature populaire ou le cinéma, réduite au sexe faible, oubliées ou absentes des livres d’Histoire. ». Cette réhabilitation est un échec, et son parti-pris féministe est contredit par la légèreté, voire la futilité du propos qui, on l’espère, n’est pas censé être à l’image des femmes qu’il évoque. Apparemment si, puisque le visiteur à la possibilité de découvrir le château avec une visite guidée ayant pour thème « Sous les jupons des reines. »
Musée de la Vie romantique : Héroïnes romantiques
Le Musée de la Vie Romantique s’arrête quant à lui sur les héroïnes romantiques, de la fin du XVIIIe aux années 1850. Le sujet s’annonçait passionnant, le visiteur pourtant reste sur sa faim. Le parcours thématique est un peu simpliste, qui se contente de proposer une typologie très sommaire de femmes : les héroïnes du passé, les héroïnes de la littérature, et les héroïnes sur scène.
-

- 5. Antoine-Jean Gros (1771-1835)
Sapho à Leucate, 1801
Huile sur toile - 118 x 95 cm
Bayeux, Musée d’art et d’histoire Baron Gérard.
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
Ainsi la première section convoque des personnages aussi bien mythologiques qu’historiques, étrange pot-pourri où se mêlent Sapho et Jeanne d’arc, les amours contrariées de la jeune Héloïse et la lutte pour le trône de Marie Stuart. Antigone est là aussi, tout comme Cléopâtre dont la présence ne semble pas indispensable dans la mesure où elle fut abondamment représentée à toutes les époques, offrant aux artistes le prétexte de montrer une femme nue et sensuelle. Les styles des œuvres sont tout aussi variés que les personnages : la Sapho de Gros est déjà romantique (ill. 5), la mort d’Antigone est mise en scène par Victorine-Angélique Genève-Rumilly, élève du peintre néo-classique Jean-Baptiste Regnault, tandis qu’Héloïse inspire le pinceau troubadour de Jean-Antoine Laurent. Or, distinguer les styles n’aurait-il pas permis de montrer des interprétations différentes de l’héroïsme au féminin ?
Cette première salle annonce le parti pris réducteur de l’exposition : les femmes sont des victimes. « En écho à la condition féminine du premier XIXe siècle, fortement défavorisée par le code civil napoléonien de 1804, les héroïnes romantiques incarnent un modèle féminin sacrifié. » Antigone et Jeanne d’Arc, seraient donc des femmes sacrifiées ? Elles sont au contraire des exemples de « femmes fortes » qui affrontent sans ciller leur destin, certes tragique. Si leur mort et même leurs moments de fragilité sont les épisodes privilégiés par les artistes du XIXe siècle, ces figures incarnent bel et bien le courage, le sens du devoir et une force d’âme qui n’a rien à voir avec les tourments de la passion. Jeanne est ainsi peinte sur le bucher par Evariste Fragonard, ou jetée en prison par Claudius Jacquand. Mais Marie d’Orléans la montre à la fois en armure et en prière dans une célèbre sculpture. « Le regain d’intérêt pour la religion au début du XIXe siècle transforme certaines héroïnes en saintes ou en martyres. La piété de Jeanne d’Arc est ainsi mise en avant dans les œuvres sculptées de Marie d’Orléans ». Il est un peu étonnant d’attribuer aux artistes la sanctification de Jeanne, elle dont toute l’action fut mue par la foi et qui fut, de fait, canonisée par la suite ; certes tardivement, mais la question fut posée très tôt et la première étape de cette canonisation, appelée « introduction à la cause », survint en 1869.
-

- 6. Félicie de Fauveau (1801-1886)
Christine de Suède refusant la grâce à son écuyer Monaldeschi, 1827
Plâtre teinté - 40 x 58 cm
Louviers, Musée de Louviers
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
Et si l’exposition souligne ce regain d’intérêt pour la religion pourquoi alors, ne pas avoir intégré les saintes dans ce parcours, qui peuvent elles aussi être des héroïnes romantiques, tout comme les femmes de l’Ancien Testament, parmi lesquelles Judith qui tua Holopherne pour sauver son peuple . Pourquoi ne pas avoir invité les figures les plus modestes héroïsées par les artistes, telle la Jeune orpheline au cimetière ? Pourquoi ne pas avoir intégré non plus les allégories, qui occupent une place importante dans l’art du XIXe siècle : la Charité, la Liberté, la France ou encore La Grèce sur les ruines de Missolonghi sont incarnées par des femmes.
Seule La Liberté guidant le peuple est évoquée par une lithographie exposée dans une petite salle attenante à la première, consacrée à « la question de la violence féminine », où se côtoient Médée et Christine de Suède... Toutes les mêmes ! Ces « figures célèbres incarnant la folie et la violence impressionnent les artistes [...] à une époque où la violence est considérée comme inconciliable avec la "nature" féminine. ». Médée qui tua ses enfants pour se venger de Jason - esquisse à l’huile de Delacroix -, est-elle mue par les mêmes sentiments que Christine de Suède, qui fit exécuter son écuyer Giovanni Monaldeschi soupçonné de trahison - sculpture de Félicie de Fauveau (ill. 6) ? Dans cette pièce se trouvent aussi Charlotte Corday arrêtée après l’assassinat de Marat, La Liberté guidant le peuple, ainsi que Marguerite - qui tua l’enfant qu’elle eut avec Faust. Une figure de l’histoire contemporaine, une allégorie et un personnage de fiction. Le pot-pourri devient bouillabaisse.
Cette première partie cantonne donc les femmes au rôle de victimes sacrifiées d’un côté, à celui de folles furieuses de l’autre. La répartition ne fait pas dans la dentelle, et tant pis pour celles qui furent des exempla virtutis, c’est à dire des exemples de vertu au sens étymologique du terme. Le mot virtus étant dérivé du mot vir - homme - , la virtus est la vaillance physique et la valeur morale dont un homme doit faire preuve.
Un autre parti-pris est contestable : « Puisqu’elles sont l’objet d’un regard masculin, elles sont souvent érotisées ou figurées pour leurs qualités supposées féminines telles que la grâce, la fragilité, la sensibilité, le dévouement. ». Pas de chance ! Pour une fois que des femmes artistes étaient exposées avec des hommes, les voila complètement effacées par le discours ! Elles sont bien là pourtant, Marie d’Orléans et Félicie de Fauveau qui déclinent au contraire des images de femmes fortes ! Peut-être auraient-elles mérité un petit laïus.
-

- 7. Marie-Victoire Jaquotot (1772-1855)
d’après François Gérard
Corinne au cap Misène, 1825
Peinture sur porcelaine - 59 x 48,5 cm
Sèvres, manufacture et musées nationaux de Sèvres
Dépôt du Musée du Louvre
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
La seconde section présente les « Héroïnes de fiction » qui expriment l’impossible conciliation entre un ordre social établi et la liberté de vivre leurs passions. Dans les années 1820, le théâtre de Shakespeare suscita l’engouement du public français, et donc des artistes. Juliette, Ophélie, Desdémone s’alanguissent sur les toiles d’Eugène Delacroix ou de Léopold Burthe. Les écrivains français créèrent eux aussi des héroïnes qui inspirèrent les peintres : Esmeralda de Victor Hugo, Atala et Velléda de Chateaubriand furent par exemple représentées par Léon Cogniet et Anne-Louis Girodet.
Là encore, on se demande où sont passées les écrivaines. Le genre du roman est en pleine essor, précise-t-on dans l’exposition. Or elles furent nombreuses à écrire au XIXe siècle, Madame de Staël, Madame de Genlis, Claire de Duras, la comtesse de Dash qui collabora avec Alexandre Dumas, sans oublier bien sûr Marie d’Agoult qui publia ses romans sous le nom de Daniel Stern et Aurore Dupin, alias George Sand, parce qu’une femme « comme il faut » ne pouvait publier sous son nom.
C’est à cette époque qu’apparut l’expression « bas-bleu » qui n’avait rien de péjoratif... au début. « Les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes. Ce sont des hommes — du moins de prétention — et manqués ! Ce sont des Bas-bleus. »
George Sand est présente à travers deux œuvres de Delacroix : le portrait de l’auteur et un pastel illustrant la dernière scène de son roman, Lélia. Sophie Cottin aussi, grâce à un tableau de Rosalie Caron qui dépeint Mathilde et Malek-Adhel au tombeau de Montmorency.
Et les autres ? Marie d’Agoult eut une vie rocambolesque, quittant son mari pour s’enfuir avec Liszt. Son portrait fort sage par Henri Lehmann se trouve à Carnavalet. Quant à Madame de Staël, il est stupéfiant que son personnage de Corinne ne soit pas mis en valeur. La peinture sur porcelaine de Marie-Victoire Jaquotot (ill. 7) qui reprend une composition de François Gérard, Corinne au cap Misène, n’est accompagnée d’aucun commentaire sur l’héroïne. Corinne aurait pourtant permis de contrebalancer ces magnifiques mollusques érotiques et pâmés que sont les héroïnes de fiction dans la peinture de l’époque. Voila une femme qui affronte l’inconfort de sa condition sociale, rue dans les brancards, refuse de se soumettre. Et sa défaite est triomphale. Le roman qui relate l’histoire d’amour entre une poétesse italienne, Corinne, et Lord Oswald Nelvil, aborde la question de la condition féminine et du droit de la femme à être indépendante et à exister en tant qu’écrivain. Corinne renvoie à Madame de Staël elle-même qui fut d’ailleurs admirée par Stendhal, par Benjamin-Constant et même par son grand ennemi, Napoléon.
Les portraits de toutes ces écrivaines méritaient d’autant plus de figurer dans cette exposition que la dernière section présente les effigies des grandes comédiennes, cantatrices et danseuses de l’époque qui incarnèrent toutes ces héroïnes. Pourquoi mettre en valeur les interprètes et oublier les auteurs ? Elles auraient pu aussi fait l’objet d’un essai dans le catalogue. Malheureusement celui-ci mélange les genres, en proposant des textes qui ne sont ni des notices ni des essais, mais un mélange des deux. Certaines œuvres offrent ainsi le prétexte au développement de thèmes variés, « misogynie », « sensibilité », mais aussi « la statuette-portrait » ou bien « le code civil ». Des textes très courts d’une page, qui réduisent les œuvres au statut d’illustrations. Les écrivaines sont citées dans un article sur « le roman sentimental ».
-

- 8. Auguste Clésinger (1814-1883)
Rachel dans le rôle de Phèdre, vers 1850
Marbre - 177 x 40 x 40 cm
Collection Patrice Benadon
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
L’exposition se conclut sur le théâtre, le ballet et l’opéra. Rachel dans son rôle de Phèdre fut sculptée par Auguste Clésinger (ill. 8) et peinte par Frédérique O’Connell, ; Marie Taglioni, à jamais identifiée comme la Sylphide, évolue dans une série de lithographies d’Alfred Edward Chalon. La Sylphide inspirée des légendes celtes et germaniques apparut dans le monde de la danse, illustrant l’idéal d’une femme immatérielle, vêtue de vaporeux tutus blancs et chaussée de pointes ; une nouvelle manière de danser se développa, caractéristique du ballet romantique.
La Malibran incarne l’opéra romantique, représentée dans son rôle de Desdémone, par François Bouchot et par Henri Decaisne. Mademoiselle Mars elle aussi fut Desdémone, au théâtre, dans des pièces d’un nouveau genre, les drames romantiques. Elle ne fut pas qu’un personnage victime de la passion, elle fut une femme haute en couleurs qui resta fidèle à Napoléon, et porta des violettes à son corsage pour bien marquer son opposition au « parti du lys » . C’est elle aussi qui déclara « une femme avec un éventail est plus forte qu’un homme avec une épée ».
Musée du Luxembourg : Pionnières
Après les femmes artistes du XVIIIe, voici amassées dans l’espace relativement restreint du Luxembourg les Pionnières des années Folles. Le musée persiste et signe, les travers de cette exposition sont les mêmes que ceux de la précédente (voir l’article) : des artistes beaucoup trop nombreuses, des sections floues, un discours caricatural et des informations à trous, façon gruyère.
Certaines œuvres sont commentées sur des cartels, d’autres le sont seulement dans l’audio-guide. Le visiteur qui a choisi de ne pas le prendre pour des raisons diverses - la liberté de déambuler ou bien tout simplement le prix, 5 euros qu’il faut ajouter aux 13 euros du prix d’entrée - est donc doublement puni : non seulement il n’a pas accès à toutes les informations, mais il peine à se concentrer sur les textes, cerné par le cacophonie des audioguides dont le son est très mal isolé. Et puis il y a certaines œuvres et certaines artistes qui ne bénéficient tout bonnement pas de commentaire ; sans doute parce qu’elles n’ont pas d’intérêt ? C’est le cas par exemple d’Anna Beöthy-Steiner et de Rita Kernn-Larsen.
La vedette de l’exposition est bien évidemment Tamara de Lempicka qui bénéficie d’une section dédiée réunissant quatre ou cinq œuvres (ill. 9). Chana Orloff elle aussi est bien représentée avec cinq ou six sculptures, mais peu d’informations à leur sujet. Les autres artistes sont évoquées par une, voire deux créations, elles resteront donc méconnues. Ainsi deux costumes conçus par Sarah Lipska sont accompagnés d’un cartel qui précise qu’elle fut scénographe et costumière pour les Ballets russes aux côtés de Léon Bakst, mais aussi sculptrice, peintre, décoratrice d’intérieur et designer, collabora avec Monsieur Antoine, coiffeur, inventeur de la coupe à la garçonne, avec Helena Rubinstein également, ou encore avec le couturier Paul Poiret. Le visiteur est prié d’imaginer le reste de son œuvre, elle qui fut internationalement reconnue et récompensée de plusieurs médailles.
-

- 9. Tamara Rozalia Gurwik-Górska dite Tamara de Lempicka (1898-1980)
La Bella Rafaela, 1927
Huile sur toile - 63,5 x 91,44 cm
Collection particulière
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
La première section, « comment les avant-garde se conjuguent au féminin » prouve qu’il est inepte de séparer les femmes des hommes. Marlow Moss fut ainsi marquée par Piet Mondrian. Elle correspondit avec lui de 1929 à 1938, et inventa la double ligne pour rendre ses compositions plus dynamiques, innovation reprise par Mondrian en 1932. De même Franciska Clausen et Marcelle Cahn furent directement influencées par leur maître, Fernand Léger.
Le propos est souvent sibyllin pour ne pas dire abscons. « De nombreuses femmes artistes ont alors été attirées par l’abstraction qui leur permettait de s’affranchir des catégories de genre, contrairement à la figuration qui l’impose ». Compte tenu de la tonalité générale de cette exposition, on hésite à interpréter le terme « genre » dans cette phrase. En effet, la hiérarchie des genres n’étant plus d’actualité dans les années 1920, cette remarque n’est pas claire. Par ailleurs, il serait dévalorisant d’affirmer que l’abstraction fut un choix par défaut, que certaines auraient fait pour échapper aux contraintes de la figuration. Le visiteur perplexe peine à comprendre et en vient à se demander si « le genre » n’est pas ici l’identité sexuelle, comme c’est le cas tout au long du parcours qui l’emmène de la section sur « les garçonnes », à celle sur « les deux amies », en passant par « le troisième genre ».
La profusion et la diversité des œuvres noient le propos. L’exposition s’ouvre sur les avant-gardes, avec un extrait de film de Germaine Dulac , projeté face à des peintures abstraites et des photographies de Gisèle Freund. Puis apparaît une robe de Coco Chanel, à côté des poupées de Stefania Lazarska, des marionnettes de Marie Vassilief, des poupées en bas-reliefs d’Alice Halicka. Viennent ensuite le thème du nu, celui du portrait - présenté comme le genre de prédilection des femmes dans les années 1920, mais il l’était déjà au XVIIIe siècle - et enfin des œuvres « multi-ethniques ». Chaque partie aurait semble-t-il mérité une exposition en soi.
-

- 10. Vue de l’exposition
Chana Orloff (1888-1968)
Moi et mon fils, 1927
Maternité couchée, 1923
Bronze
Paris, Atelier-Musée Chana Orloff
Photo : bbsg - Voir l´image dans sa page
Le discours caricatural finit par hérisser le poil, révélateur de notre société plus que de celle des années 1920 : les femmes qui peignent des nus se réapproprient le corps, forcément. « Le regard désirant des hommes est remplacé par un regard complexe » ce qui ne veut rien dire. D’ailleurs le regard de Lempicka souligne tout autant la sensualité d’un corps féminin et le désir qu’il inspire.
Quant à Chana Orloff, il devait sembler insupportable aux commissaires qu’elle ait fait de la maternité son sujet de prédilection (ill. 10). Le thème est bien trop traditionnel dans l’histoire de l’art, les représentations de la Vierge et l’Enfant remontant à la nuit des temps. Alors il fallait en donner une interprétation acceptable : « Les sculptures de mères autonomes et indépendantes d’Orloff exaltent une vision puissante de la femme capable d’assumer à la fois le rôle des deux parents et celui d’une artiste à succès vivant de son art. » Si l’on comprend bien, Orloff représente donc la femme moderne célibattante qui mène sa carrière et s’occupe de ses enfants sans l’aide d’un homme, incarnant la fois le rôle de la mère et du père, mieux que cela, le rôle de parent 1 et de parent 2.
Les femmes luttent pour s’imposer. Et puis les femmes sont gentilles et tolérantes. « Parce qu’elles étaient laissées de côté, les femmes étaient ouvertes sur le monde, ouvertes à d’autres cultures, parce qu’elles ne sont pas reconnues, elles sont sensibles aux cultures qui ne sont pas les leurs. Lucie Couturier et Anna Quinquaud voyagent en Afrique et offrent une représentation non stéréotypée du peuple africain ». Ces deux artistes n’ont rien à voir. Pour Anna Quinquaud nous renvoyons à l’exposition de Roubaix en 2013, tandis qu’Orsay abordait la question du modèle noir dans une exposition plus subtile (voir l’article).
Voici donc dans cette dernière section réunis deux sujets à la mode qui sont au cœur des préoccupations de bien des musées actuellement : les femmes artistes et les modèles noirs. Pas de doute cette exposition est dans le vent, et brasse de l’air.
Commissaires :
« Héroïnes romantiques » : Gaëlle Rio, directrice, musée de la Vie romantique. Elodie Kuhn, directrice adjointe.
« Pionnières » : Camille Morineau, conservatrice du patrimoine et directrice d’AWARE - Archives of Women Artists, Research and Exhibitions. Lucia Pesapane, historienne de l’art.
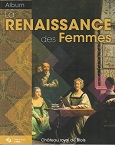 Collectif, La Renaissance des Femmes, Blois 2022, 54 p., 10 €. ISBN : 9782958255404
Collectif, La Renaissance des Femmes, Blois 2022, 54 p., 10 €. ISBN : 9782958255404
 Collectif, Héroïnes romantiques, Éditions Paris Musées 2022, 144 p., 29,90€. ISBN : 9782759605156
Collectif, Héroïnes romantiques, Éditions Paris Musées 2022, 144 p., 29,90€. ISBN : 9782759605156
 Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles, Flammarion 2022, 40 €. ISBN : 9782711879076
Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles, Flammarion 2022, 40 €. ISBN : 9782711879076
Informations pratiques : Château royal de Blois, 6, place du Château, tél. : +33 (0)2 54 90 33 33. Ouvert tous les jours de 9h à 18h30/19h. Tarif : 13€ (réduit 10€ )
Musée de la Vie romantique, Hotel Scheffer-Renan, 16 rue Chaptal 75009 Paris. Tél : +33 (0)1 55 31 95 67. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Tarif plein 9€ (réduit 7€)
Musée du Luxembourg, 19 rue de Vaugirard 75006 Paris - Tél. : 01 40 13 62 00. Ouvert tous les jours de 10h30 à 19h, nocturne le lundi jusqu’à 22h.
